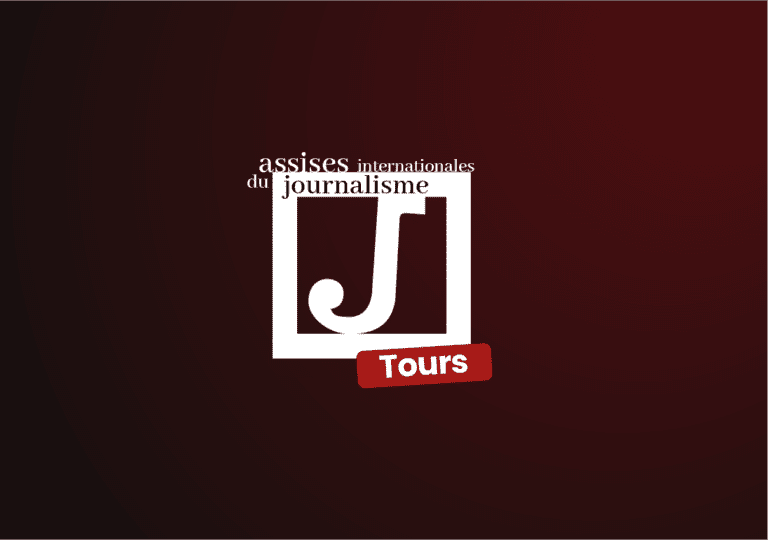Patrick de Saint-Exupéry présidait le jury des Prix des Assises lors de la 7ème édition de la manifestation qui avait lieu à Metz en novembre 2013.
Il succède ainsi à Géraldine Muhlmann, Pierre Haski, Nicolas Demorand, Audrey Pulvar, Bruno Frappat et Edwy Plenel.
Patrick de Saint-Exupéry est cofondateur et rédacteur en chef de la revue XXI, après avoir été grand reporter pendant vingt ans au Figaro.
Il a reçu le prix Albert Londres, le Prix Mumm et le Prix Bayeux des correspondants de guerre.
Les Prix des Assises Internationales du Journalisme et de l’Information récompensent chaque année les publications parues dans les 12 derniers mois qui interrogent le mieux le journalisme et éclairent la pratique du métier.
Deux ouvrages sont distingués par un jury pluridisciplinaire, composé à la fois de journalistes et de chercheurs, qui décerne deux prix :
Le Prix « Journalisme » est attribué à un ouvrage de réflexion, de témoignage ou d’enquête sur le journalisme et sa pratique.
Le Prix « Recherche » récompense une publication de recherche sur le journalisme.
Enfin, à travers le Prix « Enquête et Reportage », les Assises récompensent aussi le meilleur article ou documentaire paru sur l’exercice du journalisme. Ce prix est attribué par un jury d’étudiants issus des 13 écoles de journalisme reconnues par la profession, sous la houlette du Président du Jury.